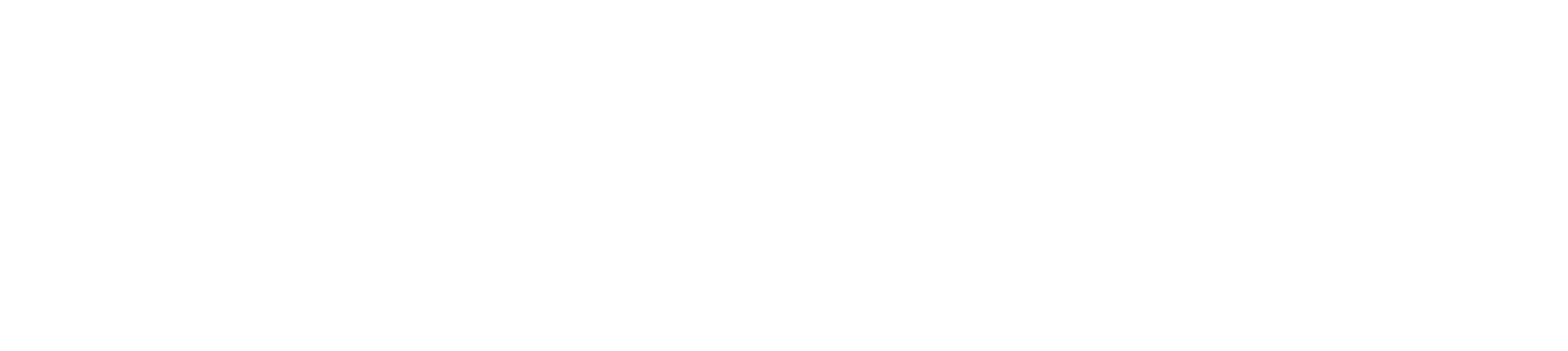Transformer ses déchets alimentaires en ressource utile, c’est possible, et souvent plus simple qu’on ne l’imagine. Faire du compost ne demande ni jardin, ni compétences particulières, ni matériel complexe mais quelques principes de base à comprendre, et quelques erreurs faciles à éviter.
Dans ce guide, vous découvrirez comment fonctionne réellement le compostage, comment choisir la méthode adaptée à votre situation, et comment réussir un compost efficace, sans odeurs ni nuisibles. Que vous soyez en maison, en appartement, ou dans une structure professionnelle, vous trouverez ici des repères concrets pour passer à l’action.
Qu’est ce que le compost ?
Le compost est le résultat d’un processus naturel de dégradation des matières organiques, en présence d’oxygène, d’humidité et d’une diversité de micro-organismes. Il produit une matière stable, riche en humus, qui améliore la structure et la fertilité des sols.
Autrement dit : ce que l’on jette (épluchures, marc de café, restes végétaux…) peut redevenir un amendement organique utile, à condition de suivre quelques règles simples.
Ce processus n’est ni sale, ni dangereux, ni complexe. Il repose sur un équilibre biologique entre les apports, l’air et l’eau.
Quels sont les différents types de compostage ?
Il existe plusieurs méthodes de compostage. Elles ont toutes le même objectif, mais s’adaptent à différents contextes d’espace, de volume ou de fréquence d’utilisation.
Compostage aérobie (c’est à dire “en présence d’oxygène”, le plus courant)
- Nécessite un brassage régulier
- Permet une dégradation efficace, sans odeurs, avec un bon suivi
C’est le mode de compostage utilisé dans les composteurs domestiques classiques, les composteurs partagés, ou en entreprise.
Il peut prendre différentes formes, selon le matériel utilisé :
- Compostage en bac statique(classique dans les jardins)
- Composteur rotatif, qui facilite l’aération par un brassage régulier. En fabrication artisanale / DIY chez les particuliers, ce système est aussi utilisé par Easy To Compost en raison de sa simplicité et son efficacité dans les modèles pour les entreprises ou collectivités.
- Composteur électromécanique (branché à l’électricité), qui automatise certaines fonctions (aération, température, brassage) : ce type d’équipement est adapté aux structures traitant des volumes plus importants, avec des budgets plus élevés et des équipes de maintenance.
Lombricompostage
- Utilise des lombrics, ce sont des vers de terre naturellement présents dans les sols, dont certaines espèces sont connues pour leur utilité dans le compostage (les vers Eisenia fetida, notamment)
- Adapté aux petits volumes, en intérieur ou sur balcon
- Très peu d’odeurs, compost rapide, mais sensible aux variations de température ou aux erreurs d’apport.
- Le compost produit est très concentré, avec un “jus” (appelé thé de compost) riche mais à diluer pour être utilisé comme fertilisant.
Idéal pour les appartements, petits bureaux ou établissements scolaires.
Bokashi (fermentation anaérobie)
- Procédé sans oxygène, basé sur l’ensemencement avec des micro-organismes (EM).
- Le système bokashi est basé sur la fermentation des déchets, dans un seau étanche, à l’aide de micro-organismes spécifiques. Ce processus est anaérobie(sans oxygène) : il ne produit pas de compost à proprement parler, mais une matière pré-digérée, qui devra ensuite être enfouie ou intégrée à un compost traditionnel pour finir sa maturation.
- Il peut être utile pour les petits espaces ou une première étape de traitement, mais ne fonctionne pas seul à long terme.
Solution compacte, efficace en intérieur, mais nécessite une étape complémentaire de maturation.
Compostage en tas ou en fosse
- Méthode rustique : amas au sol ou dans une cavité
- Nécessite de l’espace, peu adaptée aux milieux urbains
- Lent mais peu contraignant
Pertinent pour les jardins, fermes, ou espaces ruraux peu fréquentés.
Le choix du composteur dépend de plusieurs critères : la place disponible, la quantité de biodéchets produite, le type de bâtiment (individuel ou collectif), l’environnement (urbain ou rural) et les usages (domestique ou professionnel).
| Type de composteur | Pour quel usage ? | Avantages | Limites |
| Composteur de jardin | Maison individuelle avec espace extérieur | Robuste, grande capacité | Nécessite un peu d’entretien |
| Composteur rotatif | Usage domestique régulier | Brassage facile, compost plus rapide | Capacité limitée |
| Composteur électromécanique | Cantine, restauration collective, entreprise | Automatisé, rapide, sans nuisance | Coût élevé, besoin d’alimentation électrique |
| Lombricomposteur | Appartement, bureau, intérieur | Sans odeur, peu encombrant | Sensible à la température et à l’humidité |
| Bokashi | Cuisine intérieure | Compact, rapide, peu d’entretien | Résultat à enterrer ou à composter ensuite |
| Composteur partagé | Copropriété, quartier | Mutualisation, lien social | Demande une bonne coordination |
Certains appareils vendus comme “composteurs de cuisine” sont en réalité des déshydrateurs. Ils chauffent les biodéchets à haute température, les dessèchent puis les broient. Le résultat obtenu est un résidu sec, inerte, sans activité biologique.
En plus de la consommation d’énergie importante de la machine, contrairement à un compost mûr, ce résidu :
n’enrichit pas les sols en matière organique vivante, ne constitue pas un amendement complet, doit souvent être enfoui ou jeté. Ces appareils peuvent avoir une utilité ponctuelle (réduction de volume dans les cuisines), mais ils ne produisent pas de compost. Ils ne remplacent donc ni le compostage domestique, ni une gestion sérieuse des biodéchets.
Pourquoi faire du compost ?
Faire du compost répond à trois enjeux concrets :
Nourrir les sols
Les sols se dégradent, s’érodent, perdent leur capacité à retenir l’eau ou à héberger la vie microbienne. Le compost permet :
- de restituer de la matière organique stable,
- d’améliorer la structure des terres cultivées ou urbaines,
- de participer activement à la régénération des sols.
Éviter de transporter (et brûler) des déchets organiques
Un biodéchet jeté avec les ordures ménagères est collecté par camion, transporté parfois sur des dizaines de kilomètres, incinéré ou enfoui… alors qu’il est humide (environ composé à 80% d’eau en moyenne!) et valorisable localement. Composter permet de traiter les déchets là où ils sont produits, sans transport ni infrastructure lourde, et d’éviter des traitements coûteux et peu efficaces.
Mieux maîtriser ses flux de déchets (et ses coûts)
Depuis janvier 2024, le tri à la source des biodéchets est devenu obligatoire pour tous. Composter permet donc de limiter les volumes collectés (et donc la facture) et d’avoir une solution tangible et facilement compréhensible pour les usagers (en particulier en entreprise ou collectivité).
Guide pratique du compostage : comment ça fonctionne ?
Que mettre dans un composteur ?
Un compost fonctionne grâce à l’activité de micro-organismes et d’insectes qui transforment les déchets en humus. Pour cela, ils ont besoin de deux grands types d’éléments : les matières riches en azote (déchets frais, dits “verts”) et les matières riches en carbone (matières sèches, dites “brunes”).
Pourquoi faut-il équilibrer azote et carbone ?
C’est une question d’équilibre énergétique et biologique. Le carbone est la principale source d’énergie des micro-organismes. L’azote, lui, sert à leur croissance et à la fabrication de leurs enzymes. Si l’on met trop de déchets azotés (épluchures, marc de café, herbes fraîches), on crée un excès d’humidité, d’acidité et d’odeurs désagréables. Si l’on met trop de matières sèches, la dégradation s’arrête.
L’équilibre optimal : environ deux tiers de matières brunes pour un tiers de matières vertes, en volume.
Quelques astuces à connaître

- Les coquilles d’œuf broyées aident à réguler l’acidité du compost, surtout si vous mettez beaucoup de fruits ou d’agrumes.
- Le marc de café, riche en azote, est aussi un répulsif naturel contre certains insectes.
- Le papier essuie-tout peut être composté s’il n’est pas gras ou imprimé.
Pourquoi certains déchets sont à éviter ?
Les restes de viande, de poisson, les produits laitiers ou les plats cuisinés gras ne se décomposent pas bien en compostage domestique. Ils attirent les nuisibles (rats, mouches) et créent des fermentations anaérobies, synonymes d’odeurs et de stagnation du processus.
Les matières grasses, quant à elles, enrobent les autres déchets et empêchent l’oxygène de circuler dans le tas.
Enfin, les déchets non organiques (plastiques, litières minérales, bois traités) sont simplement… non compostables.
Comment bien choisir l’emplacement de son composteur ?
Le lieu d’installation du composteur influence directement la réussite du processus. Il doit être accessible, stable, et adapté au type de composteur utilisé.
Composteur de jardin ou bac statique
En extérieur, privilégier une zone :
- À même le sol, pour permettre l’accès aux vers de terre et insectes
- Semi-ombragée, pour limiter les excès de chaleur ou d’humidité
- Abritée du vent fort, qui dessèche le contenu
- Facile d’accès même en hiver
- Évitez les surfaces bétonnées : l’absence de contact avec la terre freine l’activité biologique naturelle. Et pensez à prévoir un espace pour stocker un peu de “matière brune sèche” à portée de main (feuilles mortes, carton déchiqueté…).
Composteur rotatif
Ce type de composteur est fermé et surélevé : il peut être installé sur n’importe quelle surface plane, y compris une terrasse ou une dalle. Il faudra toutefois veiller à le remplir progressivement, en respectant les équilibres entre azote et carbone, car l’absence de sol implique une activité microbienne plus limitée au départ.
Lombricomposteur
C’est un système vivant : les vers sont sensibles à la température, à l’humidité et à la lumière.
- Température idéale : entre 15 et 25 °C
- En dessous de 10 °C : l’activité ralentit
- Au-dessus de 30 °C : les vers risquent de mourir ou de fuir
À éviter : les rebords de fenêtre, les placards mal ventilés, les caves humides ou les balcons en plein soleil.
Un lombricomposteur s’installe de préférence dans un coin discret mais tempéré : cuisine, bureau, garage isolé…
Bokashi
Ce système étant totalement fermé, il peut être installé dans n’importe quelle cuisine, y compris professionnelle. Pas besoin de contact avec le sol, ni d’aération : la fermentation est anaérobie. Attention cependant à bien vider le jus de fermentation régulièrement (tous les 2 à 3 jours) pour éviter la macération. Un composteur discret, mal placé ou mal identifié sera peu utilisé. Un composteur visible, bien dimensionné, et accompagné d’une petite animation ou d’un affichage peut au contraire susciter une vraie adhésion collective.
Comment entretenir son compost ? les bons gestes à adopter
Contrairement à une idée reçue, un composteur n’est pas une “poubelle verte” autonome. C’est un écosystème vivant, qui demande une certaine régularité pour fonctionner correctement. Rien de compliqué, mais quelques gestes simples font toute la différence.
Aérer régulièrement le composteur
Un compost a besoin d’oxygène pour permettre à la vie microbienne de se développer. Sans air, ce sont des bactéries anaérobies qui prennent le relais : elles génèrent des odeurs désagréables, ralentissent la dégradation et favorisent la fermentation.
→ Brasser le compost (avec une fourche ou un aérateur manuel) une fois toutes les deux semaines suffit, ou à chaque ajout si le volume est important.
→ Dans un composteur rotatif, le brassage est intégré : il suffit de le tourner deux ou trois fois par semaine.
→ Dans un lombricomposteur, on ne mélange pas : ce sont les vers qui s’en chargent. Mais il faut ajouter du brun régulièrement pour maintenir la structure.
Vérifier l’humidité du composteur
Le compost doit être aussi humide qu’une éponge essorée. Trop sec, les micro-organismes se mettent en pause. Trop humide, les déchets s’agglutinent et pourrissent.
→ Si c’est trop sec : ajoutez un peu d’eau en pluie fine, ou quelques déchets humides bien répartis.
→ Si c’est trop humide : ajoutez du brun (carton, feuilles sèches), aérez, et laissez le couvercle entrouvert quelques jours.
Apporter du brun à chaque apport de vert au composteur
À chaque fois que vous ajoutez des déchets alimentaires (matières humides riches en azote), ajoutez une petite poignée de matière sèche (brun) pour maintenir l’équilibre. Cela favorise l’aération, évite les mauvaises odeurs, et limite l’arrivée de moucherons.
En entreprise ou dans une cantine, prévoir un petit seau de brun sec à côté du composteur est une bonne pratique simple à mettre en place.
Observer le compost
Un bon compost dégage une légère odeur de sous-bois. Il est peuplé de petites bêtes utiles (vers, cloportes, collemboles, cétoines). Leur présence est normale et même souhaitable. En revanche, si des nuisibles apparaissent (moucherons, mouches, rongeurs), c’est généralement signe d’un déséquilibre (excès de vert, manque de matière sèche, apport de restes cuisinés).
Combien de temps faut-il pour obtenir du compost ?
La durée dépend de plusieurs facteurs : le type de composteur, le climat, la régularité des apports, la taille des déchets et la qualité de l’entretien.
Comment reconnaître un compost mûr ?

- Il a une odeur de terre forestière, pas d’ammoniac ou de fermentation.
- Sa texture est homogène, foncée, légèrement grumeleuse.
- On n’y distingue plus de déchets reconnaissables (sauf les plus durs, comme des noyaux ou coquilles d’œuf).
- Il est friable et ne colle pas aux doigts.
Comment fabriquer son composteur soi-même ?
Il est tout à fait possible de construire un composteur fonctionnel avec peu de moyens.
Fabriquer un composteur de jardin (à base de palettes)
- 3 à 4 palettes en bois pour les parois
- Une bâche ou un couvercle pour protéger de la pluie
- Une base sans fond (directement sur la terre)
- Une ouverture frontale pour le retournement
Simple, robuste, et idéal pour les jardins de taille moyenne à grande.
Fabriquer un lombricomposteur maison
- 3 bacs empilés type boîtes alimentaires
- Des trous dans les bacs supérieurs pour la circulation des vers
- Un bac du bas pour récupérer le jus (“thé de compost”)
- Un couvercle aéré
Foire aux problèmes les plus fréquents
“Mon compost sent mauvais”
Probablement trop de déchets humides (fruits, légumes cuits) et pas assez de brun. Aérez, ajoutez du carton, retournez le tas.
“Il y a des moucherons partout”
Apports de fruits trop visibles ou en surface, bac mal fermé, excès d’humidité. Recouvrez chaque apport avec de la matière sèche
“Mon lombricomposteur est infesté de vers blancs”
Pas nécessairement un problème : ce sont souvent des cétoines, utiles au compost. En revanche, s’il y a une odeur forte et des larves noires, attention : il faut rééquilibrer le bac.
“Mon compost ne se dégrade pas”
Manque d’humidité ou d’azote. Le compost doit rester vivant : brassez, humidifiez, ajoutez un peu de déchets frais.
“C’est trop compliqué chez moi”
Non, il faut juste choisir la bonne solution. Sur un balcon, un lombricomposteur est plus simple qu’on ne le croit. En entreprise, il existe des solutions adaptées pour tous les volumes y compris en salle de pause.